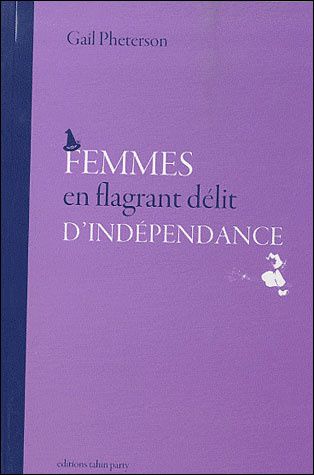"VIOLENCES SEXISTES
Par Gail Pheterson
Un arsenal repressif contre l'autonomie des femmes
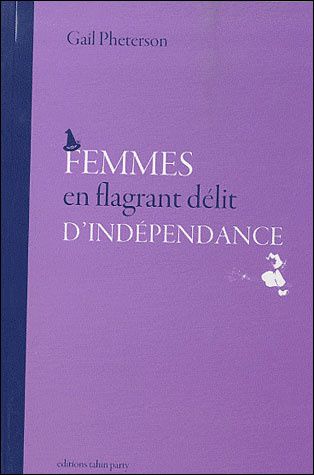
Dans cet article Gail Pheterson explique comment les féministes, dans les années 60 à 80 ont décriptés les violences sexistes comme partie intégrante d'un système social et politique qui a pour but d'empêcher l'autonomie des femmes afin de les mettre au service des hommes : dans cette perspective, les violences sexistes sont des outils de représsion dont se servent les hommes soit pour prévenir l'insubordination des femmes, soit pour la punir. Elle souligne que cette lecture sociologique des violences sexistes proposait des outils pour combattre ces violences en profondeur en s'attaquant aux strutures sociales inégalitaires qui les produisent. Elle montre ensuite comment dans les années 80 /90 jusqu'à aujourd'hui, s'opère une regression vers un certain conservatisme ayant pour effet de privilégier les explications psychologiques ou naturalisantes des violences sexistes, évacuant la responsabilité des hommes auteurs de ces violences pour ne garder que la figure du fou, du malade, du monstre ou encore de l'étranger, escamotant les rapports de pouvoir entre les sexes, ou encore présentant les violences sexistes comme une pathologie ou une fatalité spécifique aux femmes. Pour Gail Pheterson, punir ou traiter médicalement quelques auteurs de violences sexistes ne suffira pas pour venir à bout des ces violences. Elle considère que les femmes n'ont toujours pas à ce jour un statut d'être humain à part entière ce qui produit ces violences et que les femmes ne pourront sortir de cette assujetissement que si elles acquièrent les moyens qui leur permettront de jouir pleinement de leur autonomie, économique, sexuelle, mais aussi en terme de mobilité et de reproduction. Pour en savoir plus je vous invite à lire son livre...
« VIOLENCE SEXISTE(1) »
Gail Pheterson
Traduit de l’anglais par Nicole-Claude Mathieu
Extrait de « Femmes en flagrant délit d’indépendance » de Gail Pheterson, Tahin Party, 2010
PDF en ligne sur le site de Tahin Party
La violence des hommes contre les femmes fait partie du système de contrôle social propre au rapport de pouvoir entre les sexes. Il est significatif qu’elle est généralement perçue à la fois comme norme et transgression, comme coutume et crime, comme pulsion biologique et dynamique sociale. […]
Les statistiques montrent que le viol, les coups et les autres formes de violence exercées par les hommes contre les femmes sont parmi les causes majeures d’incapacité et de mort chez les femmes en âge de procréer, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. En Europe, la cause première d’invalidité ou de mort chez les femmes âgées de 15 à 44 ans est d’avoir été agressées par un homme ; dans l’Union européenne des années 1990, six cents femmes par an sont tuées par des hommes, six par mois en France(2). Au niveau mondial, on estime que les femmes perdent 9,5 millions d’années de vie par suite de la violence des hommes à leur encontre(3). Ces statistiques sont insondables et constituent un insoutenable acte d’accusation de notre société ; dans le même temps, elles n’ont rien d’extraordinaire : la brutalité des hommes envers les femmes est à la fois horrible et banale, horriblement banale. La sociologue Colette Guillaumin décrit de façon pénétrante ce paradoxe comme « […] une stupeur de connu : le “je ne peux pas le croire” du connu non reconnu. De réalité insupportable. » Comment parvenir à expliquer que soit aussi généralisée l’agression par des êtres humains envers d’autres êtres humains qui sont, le plus souvent, leurs partenaires dans la vie, dans la sexualité, dans la parenté, des personnes avec qui ils résident et qui sont leurs confidentes ? […]
Fondamentalement, la violence basée sur les rapports de genre « repose sur une longue sédimentation d’idées et de comportements quotidiens […] un phénomène diffus et familier, interne à notre société, peu ou prou intériorisé par chacun de nous […] ; ce phénomène provient de l’histoire culturelle et politique …» – formules que j’emprunte à l’analyse de Paola Tabet sur l’intériorisation par les enfants du dégoût, du mépris et de la haine envers les personnes qu’ils voient traitées en êtres inférieurs dans la société(7).
Pour comprendre et saper à la base la violence sexiste, il est essentiel d’examiner l’institutionnalisation des rapports de pouvoir entre les sexes. Bien sûr, ce ne sont pas tous les hommes – et parmi eux, même pas tous les hommes dont le sexisme est le plus manifeste – qui battent et violent des femmes. La dominance masculine prend toute une série de formes ; certains hommes peuvent entretenir des relations personnelles pleines de respect avec une femme ou même plusieurs, et en même temps ne pas remettre en question la légitimité des privilèges qu’ils possèdent en tant qu’hommes, en tant qu’êtres humains en soi, dans la société. Ce sont pourtant ces privilèges, ainsi que la soumission qu’ils requièrent de la part des femmes en tant que classe, qui maintiennent le système de genre et son arsenal de contrôles dont fait partie la violence en tant qu’avertissement contre, ou châtiment de, l’insubordination.
Il est décourageant de constater que cette perspective sociale, qui est politiquement à contre-courant des études orientées sur l’intrapsychique ou le biologique, rencontre souvent davantage de résistance actuellement qu’il y a trente ans. Je dis que c’est décourageant parce qu’une analyse sociologique est nécessaire si nous voulons théoriser et élaborer une stratégie pour un changement structurel de la société. […]
Alors que le militantisme national et international contre la violence sexiste a manifestement beaucoup augmenté au cours des dernières décennies, la compréhension théorique du rapport de pouvoir entre les sexes s’est affaiblie. Cet affaiblissement est dû au backlash, au retour de bâton, contre le féminisme (un féminisme qui analyse et perturbe ce que Gayle Rubin appelle les systèmes de sexe/genre(8) ) et à la mystification, conforme à ce backlash, quant aux fondements de l’emprise des hommes sur les femmes et de la capitulation des femmes devant les hommes.
Aperçu historique
Linda Gordon, historienne de la violence familiale aux États-Unis entre 1870 et 1960, démontre que dans les époques plus conservatrices, les gens favorisent les explications psychologiques de la violence entre les sexes alors qu’aux époques plus progressistes, on favorise les explications sociologiques(9). Les modèles psychologiques expliquent le problème en termes de désordres de la personnalité et d’expériences vécues dans l’enfance et préconisent des interventions telles que le traitement de l’individu ou sa punition; les modèles sociologiques expliquent le problème prioritairement en termes de facteurs de stress social, tels que la pauvreté, le chômage, la boisson et la solitude, et proposent des programmes pour l’égalité des droits, des subventions de l’État et des mesures d’intégration sociale. Selon Gordon, les passages d’un type d’explication à l’autre correspondent au renforcement ou à l’assouplissement du contrôle des hommes sur les femmes et du contrôle des hommes et des femmes sur les enfants. Elle écrit :
« L’inquiétude actuelle concernant les questions familiales – le divorce, la permissivité sexuelle, l’avortement, les grossesses d’adolescentes, les mères célibataires, les enfants fugueurs ou présumés volés, les droits des homosexuels – n’est pas sans précédents. Depuis au moins cent cinquante ans, il y a eu des périodes où l’on a craint que “la famille” – en fait l’image qu’on se faisait généralement de ce à quoi les familles étaient censées ressembler, et en aucune manière un souvenir exact d’une quelconque “famille traditionnelle” réelle – ne soit en déclin. De plus, les inquiétudes quant à la vie familiale ont généralement exprimé les craintes du conservatisme social vis-à-vis de l’accroissement de pouvoir et d’autonomie des femmes et des enfants et du déclin correspondant du contrôle des membres de la famille par l’homme, parfois désigné comme contrôle paternel.(10) »
Un mouvement féministe fort, plus ou moins allié aux mouvements étudiants, aux mouvements de gauche, aux mouvements pour les droits civiques et aux mouvements gays et lesbiens en Amérique du Nord et en Europe occidentale à la fin des années soixante, inaugura une vague d’études sociologiques qui démontrèrent le caractère normatif, et non pas exceptionnel, de la violence des hommes contre les femmes. Le traité de Susan Brownmiller intitulé Against Our Will (Contre notre volonté) et les études épidémiologiques extensives de Diana Russell dans les années 1970 et 1980, dont le livre intitulé Le viol dans le mariage (1982), études menées aux États-Unis, révélèrent que le viol des femmes par les hommes est un moyen traditionnel, normal quoique parfois transgressif, d’intimidation et de contrôle à l’intérieur des institutions du genre, à savoir le mariage, la prostitution, la procréation et, fondamentalement, le système hétérosexuel.
En France, durant ces mêmes années, la sociologue Colette Guillaumin écrivit son texte devenu un classique sur « Pratique du pouvoir et idée de Nature », dans lequel elle introduit la notion de sexage pour « l’économie domestique moderne, concern[ant] les rapports de classes de sexe(11) ». Le sexage, selon Guillaumin, comporte deux faces : «Un fait matériel et un fait idéologique. Le premier est un rapport de pouvoir […] le coup de force permanent qu’est l’appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes […] ; cette appropriation est basée sur la disponibilité illimitée des femmes envers les autres (notamment les hommes et les enfants, mais aussi envers d’autres dépendants sociaux), le confinement dans l’espace, la violence physique et sexuelle des hommes contre les femmes comme moyen de contrôle, et les lois et coutumes discriminatoires selon le genre […]. L’autre face du sexage est un effet idéologique : l’idée de “nature”, cette “nature” supposée rendre compte de ce que seraient les femmes.(12) »
Quelques années plus tard et dans la même ligne théorique, l’anthropologue française Nicole-Claude Mathieu publiait un texte fondamental sur les « déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes » avec pour titre principal «Quand céder n’est pas consentir(13) ». Elle analyse avec subtilité un grand nombre de schémas de sexe/genre dans des sociétés diverses et montre que « les rapports d’oppression basés sur l’exploitation du travail et du corps se traduisent par une véritable anesthésie de la conscience inhérente aux limitations concrètes, matérielles et intellectuelles, imposées à l’opprimé(e), ce qui exclut qu’on puisse parler de consentement ». Pour Mathieu : « la violence principale de la domination consiste à limiter les possibilités, le rayon d’action et de pensée de l’opprimé(e) : limiter la liberté du corps, limiter l’accès aux moyens autonomes et sophistiqués de production et de défense […], aux connaissances, aux valeurs, aux représentations […] y compris aux représentations de la domination » ; et elle souligne « qu’il n’existe pas de possibilités de fuite pour les femmes dans la majorité des sociétés(14) ». Dans le même ouvrage devenu une référence obligée : L’Arraisonnement des femmes, nous trouvons aussi l’étude monumentale de l’anthropologue italienne Paola Tabet « Fertilité naturelle, reproduction forcée(15) ». Tabet y développe une description douloureusement convaincante de la manipulation sexiste violente de la vie reproductive des femmes dans diverses cultures ; elle démontre, à l’encontre des pesanteurs de la pensée populaire, que la fonction biologique de fertilité chez les êtres humains femelles est à cent pour cent construite – et contrainte – socialement par un ensemble complexe d’interdictions et d’obligations.
Ces textes importants de Guillaumin, Mathieu et Tabet dissèquent le rapport de pouvoir entre les sexes et le système de contrôle social, y compris la menace de violence, qui est requis pour le maintenir en place. Ces théoriciennes sont des sociologues et ethnologues dont les études sur la structure sociale ont conduit à examiner minutieusement les processus psychologiques par lesquels la domination et la soumission sont intériorisées et mises en acte, et ceux qui permettent d’y résister. Mais vers la fin des années quatre-vingt, les tendances théoriques se sont considérablement détournées de l’analyse des rapports de pouvoir pour s’orienter vers des explications individuelles des comportements.
Conformément aux observations de Gordon, le conservatisme des années quatre-vingt-dix mit une fois de plus en place un discours idéologique sur les « valeurs de la famille » (y compris chez les homosexuels) d’une part, et de l’autre sur l’irresponsabilité sexuelle, l’avortement, la drogue, l’inceste et le trafic de femmes. Le discours s’est de plus en plus centré sur les « victimes », femmes et enfants, jusqu’à effacer presque complètement les hommes et le rapport de pouvoir entre les sexes. Les seuls hommes à n’être pas effacés – ou immunisés contre toute investigation – sont ceux que l’on extrait de la vie normale en les catégorisant comme des « éléments » fous, ivres, criminels ou étrangers. Les précédentes analyses montrant que la violence est interne aux rapports institutionnalisés et normatifs entre les sexes ont été laissées de côté en faveur de traitements psychologiques et de poursuites pénales contre des « individus anormaux ». Au cours des quinze dernières années, cette perspective psychologique sur les comportements de genre a structuré à la fois la recherche en sciences sociales et l’argumentaire des débats nationaux et internationaux. […]
Du rapport de pouvoir à la pathologie, à l’identité, à la fatalité ou à la maladie
Dans Le Monde du 3 mars 1995, nous trouvons le titre «Quatre millions de femmes victimes de violences conjugales ». Nulle part dans l’article les hommes ne sont mentionnés, bien que l’on puisse supposer que quatre millions de maris ont violenté quatre millions d’épouses. Bien sûr, chacun sait que ce sont les hommes les auteurs de violences à l’intérieur de l’institution légitime traditionnelle du mariage, mais ni le comportement des hommes ni le mariage ne sont identifiés comme étant le problème. A la place, l’attention est concentrée sur le psychisme et le corps des femmes. La violence conjugale, un phénomène analogue à une intoxication alimentaire, attaque spécifiquement les femmes, c’est leur sexe qui les met en danger. Celles qui succombent au risque sont par la suite identifiées comme victimes. Le fait d’être victime devient ainsi, soit un trait identitaire de femmes individuelles (La Femme Battue, dissociée des hommes qui battent), soit une condition que subissent les femmes en général (La Condition Féminine, dissociée des rapports sociaux qui la déterminent). Les hommes en tant que classe sont tranquillement soustraits à la vue et exemptés de discrédit social et de sanctions légales, tandis que seuls des hommes pathologiques ou des hommes que leur maman a négligés ou des hommes criminels asociaux sont tenus pour responsables –ou irresponsables– du problème, à savoir celui de femmes abîmées ou contaminées. La violence dite « conjugale » ou « domestique » en vient à résider à l’intérieur de la personne femme comme s’il s’agissait de quelque anomalie génétique, de quelque destin tragique ou de quelque séquelle inévitable d’une enfance traumatisée – tout cela étant des conditions exceptionnelles mais en même temps exemplaires de La Condition Féminine.
Voici un autre exemple. Les Nations unies classent « le viol et la violence domestique » (entendons : les hommes qui violent et battent des femmes) parmi les causes majeures de mort chez les femmes âgées de 15 à 44 ans(16). Lors d’une assemblée générale des Nations unies, il a été rapporté que « la violence familiale » à travers le monde a « une incidence plus néfaste sur l’espérance de vie des femmes que les cancers du sein et du col de l’utérus » (Le Monde, 7 juin 2000, p.2). La violence des hommes devient ainsi une maladie liée à l’anatomie féminine, impliquant que le corps des femmes, et non pas leur subordination sociale, est responsable du fait que les hommes les agressent et les tuent. Une telle analyse ouvre la voie à un diagnostic social et thérapeutique conduisant à traiter les femmes qui « sont victimes » des agressions masculines comme si elles étaient assaillies par une maladie mortelle spécifique à leur sexe.
Les paradoxes du système de genre
En l’absence d’une perspective sociologique, les tentatives pour comprendre, prévenir, punir la violence sexiste, ou pour s’en rétablir, sont pleines de contradictions. Car tout constat d’une situation sociale reçoit une contre-explication individuelle ou phénoménologique sous forme de «Oui, mais…» : Oui, la violence des hommes contre les femmes est un problème social, mais l’agression de la part des hommes – tout comme le fait d’être victime pour les femmes – est perçue comme une pulsion biologique ou comme la réaction d’un individu à un traumatisme de l’enfance. C’est ainsi qu’un homme qui avait tué son épouse fut décrit par un psychiatre comme « un brillant intellectuel » ayant « un trouble dépressif majeur » ; un autre homme, qui battait son épouse, fut décrit comme un individu possédant « des impulsions incontrôlables » ; et un autre, auteur d’abus sexuels sur des enfants, explique (sic) lui-même que sa mère avait été « autoritaire », « possessive », « étouffante », « exclusive » et qu’elle « n’a rien compris »(17). Tout cela peut bien être vrai, mais n’explique pas et ne disculpe pas les hommes ; cela laisse complètement de côté – et mystifie – le rapport de pouvoir qui détermine les cibles et les formes de l’agression. De plus, ces interprétations psychologiques se retournent invariablement contre les personnes subordonnées, ou bien les invisibilisent. Oui, ce sont les hommes qui commettent les violences contre les femmes, mais ce sont les femmes qu’on tient pour responsables, ou alors le dysfonctionnement de la Famille. Selon un article de L’Humanité (23/07/1994) à propos d’un homme qui s’était suicidé après avoir tué sa maîtresse et son épouse, un notable du village avait conclu : « Il aimait tant les femmes qu’elles l’ont tué. » Dans Libération, l’article sur un homme qui avait tué son épouse et leurs deux enfants était intitulé : «Une famille se suicide.(18)»
Au quotidien, les femmes auront du mal à tirer les leçons de ces messages. Où aller ? À qui faire confiance ? Oui, c’est le plus souvent chez elles et le plus souvent le soir que les femmes sont battues et violées, mais cela ne veut pas dire que les rues ou les endroits publics sont plus sûrs, surtout la nuit. Si les femmes sont davantage battues et violées à la maison que dans la rue, peut-être est-ce parce qu’elles évitent les rues à cause du danger qu’y représentent les hommes. Et si les actes de violence des hommes contre les femmes ont lieu principalement à la maison et en soirée, peut-être est-ce parce que ce sont les lieux et heures où ils se trouvent ensemble, en privé et sans témoins adultes. Oui, on estime que les hommes qui violent et battent des femmes sont des anormaux, et pourtant on apprend aux femmes à se méfier de n’importe quel homme : veillez à ne pas ouvrir votre porte à un homme ; veillez à ne pas entrer dans un lieu public fait pour les hommes , à ne pas exprimer de colère, et certainement pas de sourires, envers aucun homme.
De telles contradictions peuvent sembler incohérentes, mais leur fonction sociale est claire et logique. La double contrainte subie par la femme correspond au bon droit de l’homme. Elle doit rester à la maison pour sa propre sécurité et sa bonne réputation, mais on lui reprochera de rester avec un homme violent, surtout s’il fait du mal aux enfants ; toutefois, si elle sort et est agressée par un homme, alors on l’accusera d’être allée dans les rues, la nuit, seule, dans telle ou telle tenue. L’homme, lui, a droit à ce qu’elle le serve à la maison, et il a droit à marcher dans les rues la nuit. S’il attaque une femme à la maison, il pourra rationaliser son acte en punition parce qu’elle n’était pas disponible, et s’il attaque une femme dans un lieu public, ce sera comme punition parce qu’elle était disponible. Elle ne peut pas gagner et il ne peut pas perdre.
Ce type d’analyse sociale n’a pas bonne presse. Les hommes – et les femmes – se sentent obligés de prendre la défense des hommes gentils ou tyrannisés et de faire remarquer qu’il y a des femmes méchantes ou autoritaires. Le système du genre n’est pas seulement un lieu de danger pour les femmes et d’indignité pour les hommes, c’est aussi un lieu nostalgique de relations affectives et de cohésion culturelle. Certaines personnes défendent le statu quo en faisant remarquer qu’il existe des hommes opprimés et des femmes privilégiées à l’intérieur d’autres systèmes d’oppression, comme le racisme ou le classisme. Mais une oppression ne supprime pas l’autre. D’autres personnes évoquent une sorte de guerre entre les sexes, au lieu d’un schéma de domination, en mettant en avant des exemples de représailles violentes exercées par des femmes contre des hommes. Mais il n’y a pas de symétrie dans un rapport de pouvoir ; la violence de femmes contre des hommes, qui est statistiquement négligeable, n’exerce pas un contrôle sur toute une classe de personnes, contrairement à la violence des hommes contre les femmes.
Le système du genre est complexe et psychologiquement perturbant tant pour la partie opprimée que pour la partie dominante ; c’est « un système à fabriquer des fous » – pour reprendre une expression de Simone de Beauvoir à propos du système des classes sociales(19). La violence des hommes contre les femmes reflète et renforce des psychodynamiques, c’est certain, et en même temps (et non pas mais) elle est enracinée institutionnellement. Les réponses des femmes à cette agression ne sont ni plus rationnelles ni plus courtoises que la double contrainte qui les fait sauter d’une stratégie de résistance à l’autre. Le rapport social entre les sexes n’est pas un rapport entre des anges et des monstres, mais entre des êtres humains commis à des positions subordonnées ou dominantes dans les institutions du genre, notamment le mariage, la reproduction et la prostitution. Ces institutions sont, paradoxalement, à la fois des refuges et des cages pour les femmes et à la fois des refuges et des stands de tir pour les hommes.
Les paramètres du changement
Comment sortir de ce labyrinthe ? Quels sont les paramètres du changement ? Ce n’est pas en envoyant tel ou tel homme violent en prison… ni en psychanalyse que nous éliminerons la violence sexiste. Qu’est-ce qui porte atteinte aux femmes et qu’est-ce qui pourrait réparer le préjudice ? Que les femmes perdent des années de vie à cause des agressions des hommes est un fait avéré […].Nous savons que la violence, pour les soldats, ou les blessures physiques, pour les héros de l’athlétisme, ne revêtent pas la même signification psychologique que, pour les femmes, la violence subie à la maison ou dans la rue. Les attaques des hommes contre les femmes sont banales pour la société parce que les femmes n’ont pas le statut de soldat, même si la vie, de jour et de nuit, est pour elles une bataille. Le statut des femmes en tant que sujets est constamment mis en question. La signification psychologique – et sociologique – de la violence sexiste tient à ce que les femmes sont singularisées en tant que groupe, un groupe infra-humain, ou inférieur à d’autres humains, ou encore – et c’est tout aussi insidieux – supérieur à d’autres humains comme modèle de beauté ou de pureté. C’est ce traitement qui donne sens au préjudice.
Un changement fondamental, seul changement capable de réduire efficacement la menace et l’exercice de la violence sexiste, se doit de révéler et de contrer des rapports de pouvoir entre les sexes. Chez les femmes, le processus de changement nécessite une résistance sociale et une détermination psychologique qui soient toutes deux nourries par la compréhension des racines structurelles de leurs contraintes personnelles. Chez les hommes, le processus de changement nécessite une force psychologique et une dignité sociale ; ces qualités requièrent de comprendre le système qu’on leur a appris à pratiquer et à apprécier, de sorte qu’ils réalisent comment il se fait que le respect des femmes ne vient pas de façon «naturelle ». C’est seulement en comprenant cela que peut être mise à jour l’injustice de la violence sexiste et que peut se construire une véritable alliance entre/avec les femmes.
Notes :
1 – Conférence plénière (8 décembre 2000) au Colloque Temps et espaces de la violence, organisé par le Centre universitaire de recherche en sciences de l’éducation et psychologie (CURSEP), Université de Picardie Jules Verne, Faculté de sciences sociales et humaines, Amiens. Publié sous le titre «Violence sexiste : les racines structurelles d’une dynamique psychosociale » dans les Actes du Colloque dir. par PEWZNER Evelyne, éd. Sciences en Situation, Paris, 2006.
2 – Voir RAMONET Ignacio, « Violences mâles », Le Monde diplomatique n°604, juillet 2004. L’auteur utilise notamment le Rapport Henrion du ministère de la Santé, Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé, éd. La Documentation française, Paris, Février 2001 et consultable sur http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/violence/index.htm ; Organisation mondiale de la santé, Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, 2002 ; ENVEFF, Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale, achevée en juin 2002, éd. La Documentation française, Paris, 2003 ; Amnesty International, Mettre fin à la violence contre les femmes, un combat pour aujourd’hui, Londres, 2004.
3 – WORLD BANK, World Development Report 1993 : Investing in Health, 1993.
7 – Les citations sont extraites d’un article paru en français qui donne un aperçu de la recherche approfondie et profondément dérangeante que TABET a menée sur l’idéologie raciste chez des écoliers italiens. TABET Paola, «Comme s’ils avaient la peau juste », ProChoix n°16, Paris, nov.-déc. 2000, trad. CONTRERAS Josée, p.19-26. Pour l’étude entière, voir TABET Paola, La Pelle Giusta, éd. Einaudi, Turin, 1997.
8 – RUBIN insiste sur le fait que « Les systèmes de sexe/genre ne sont pas des émanations a-historiques de l’esprit humain ; ils sont le produit de l’action humaine, historique ». RUBIN Gayle, « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », Cahiers Études Féministes n°7, 1998, trad. MATHIEU Nicole-Claude. (Texte original : « The traffic in women : Notes on the political economy of sex » in R. REITER Rayna (ed.), Toward an Anthropology of Women, Monthly Review Press, New York and London, 1975.)
9 – GORDON Linda, Heroes of Their Own Lives. The Politics and History of Family Violence, Boston 1880-1960, Viking, New York, 1988.
10 – ibid., citation p.3.
11– « En parallèle avec certaines formes d’esclavage et de servage dans l’économie foncière, caractérisées par « l’appropriation physique elle-même, le rapport où c’est l’unité matérielle productrice de force de travail qui est prise en main, et non la seule force de travail ». GUILLAUMIN Colette, « Pratique du pouvoir et idée de Nature. I - L’appropriation des femmes. II - Le discours de la Nature. », Questions féministes 2 et 3, 1979. (Rééd. in Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de Nature, éd. Côté Femmes, Paris, 1992, p.3-82, citation p.19.)
12– ibid., citations p.16, p.41.
13 – MATHIEU Nicole-Claude (1985/1991), «Quand céder n’est pas consentir. Des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie » in L’Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes, dir. par M. N.-C., EHESS, Paris. (Rééd. in M. N.-C., L’Anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, éd. Côté-femmes, Paris, 1991, p.131-225.)
14 – ibid., citations p.215-216.
15 – TABET Paola « Fertilité naturelle, reproduction forcée » in L’Arraisonnement des femmes..., op. cit. (Rééd. in TABET P., La Construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps, éd. L’Harmattan, Paris, 1998.)
16 – Un tableau compare à l’échelle mondiale le « nombre d’années de vie perdues, corrigé par un facteur d’invalidité » en fonction de « certains traumatismes et maladies des femmes âgées de 15 à 44 ans », parmi lesquels la tuberculose, les maladies cardiovasculaires, la malaria, le cancer, et – surpassant statistiquement les cancers (9 millions d’années) – le viol et la violence domestique (9,5 millions d’années). Source : WORLD BANK, 1993, op. cit.
17 – El País, Madrid, 15 Avril 2000, p.32 ; El País, 15 Mai 2000, p.31 ; Le Monde, Paris, 7-8 Mai 2000, p.8.
18 – Le journaliste écrit : « […] une famille allemande venue se suicider mercredi en Alsace […]. Selon toute vraisemblance, le père, 50 ans, représentant de commerce, a abattu avec un pistolet 9 mm son épouse, une institutrice de 49 ans, et leurs enfants, une fille de 19 ans et un garçon de 16 ans, avant de tourner l’arme contre lui […] Faute de motif sur ce drame familial, la lettre laissée derrière lui par le chef de famille […] était accompagnée d’une somme de 400 deutschmark […] destinée aux gendarmes qui feront “le sale travail” lors de la découverte du drame […] de ce suicide familial ». SOUSSE Michel, «Une famille d’Allemands se suicide près de Strasbourg », Libération, Paris, 21 mai 1993, p.22.
19 – Simone DE BEAUVOIR utilisa cette expression à propos de l’affaire des sœurs Papin au Mans dans les années trente : le meurtre sauvage d’une patronne par ses deux bonnes. Au lieu de s’appuyer soit sur une interprétation uniquement psychique d’actes individuels, soit sur une analyse uniquement sociale, elle décrit la « paranoïa aiguë » et les « terreurs confuses » des soeurs en les intégrant dans le contexte de « tout cet affreux système à fabriquer des fous, des assassins, des monstres, qu’ont agencé les gens de bien […] ». Selon BEAUVOIR, « l’ordre social se trouvait en cause » avec « la tragédie des soeurs Papin. […] les deux soeurs s’étaient faites les instruments et les martyres d’une sombre justice. », La force de l’âge, éd. Gallimard, Paris, 1960, p.150-151.